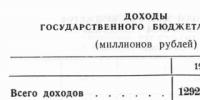Un cercle de la terre autour du soleil. À quelle vitesse la Terre tourne-t-elle ?
Depuis l’Antiquité, les gens s’intéressent aux raisons pour lesquelles la nuit cède la place au jour, l’hiver au printemps et l’été à l’automne. Plus tard, lorsque les réponses aux premières questions ont été trouvées, les scientifiques ont commencé à examiner de plus près la Terre en tant qu'objet, essayant de découvrir à quelle vitesse la Terre tourne autour du Soleil et autour de son axe.
En contact avec
Camarades de classe
Mouvement de la Terre
Tous les corps célestes sont en mouvement, la Terre ne fait pas exception. De plus, il subit simultanément un mouvement axial et un mouvement autour du Soleil.
Visualiser le mouvement de la Terre, il suffit de regarder le dessus, qui tourne simultanément autour d'un axe et se déplace rapidement sur le sol. Si ce mouvement n’existait pas, la Terre ne serait pas propice à la vie. Ainsi, notre planète, sans rotation autour de son axe, serait constamment tournée vers le Soleil d'un côté, sur lequel la température de l'air atteindrait +100 degrés, et toute l'eau disponible dans cette zone se transformerait en vapeur. De l’autre côté, la température serait constamment en dessous de zéro et toute la surface de cette partie serait recouverte de glace.
Orbite de rotation
 La rotation autour du Soleil suit une certaine trajectoire - une orbite établie en raison de l'attraction du Soleil et de la vitesse de déplacement de notre planète. Si la gravité était plusieurs fois plus forte ou si la vitesse était beaucoup plus faible, alors la Terre tomberait sur le Soleil. Et si l'attraction disparaissait ou fortement diminué, alors la planète, poussée par sa force centrifuge, a volé tangentiellement dans l'espace. Cela équivaudrait à faire tourner un objet attaché à une corde au-dessus de votre tête, puis à le relâcher soudainement.
La rotation autour du Soleil suit une certaine trajectoire - une orbite établie en raison de l'attraction du Soleil et de la vitesse de déplacement de notre planète. Si la gravité était plusieurs fois plus forte ou si la vitesse était beaucoup plus faible, alors la Terre tomberait sur le Soleil. Et si l'attraction disparaissait ou fortement diminué, alors la planète, poussée par sa force centrifuge, a volé tangentiellement dans l'espace. Cela équivaudrait à faire tourner un objet attaché à une corde au-dessus de votre tête, puis à le relâcher soudainement.
La trajectoire de la Terre ressemble à une ellipse plutôt qu'à un cercle parfait, et la distance à l'étoile varie tout au long de l'année. En janvier, la planète se rapproche du point le plus proche de l’étoile – on l’appelle périhélie – et se trouve à 147 millions de km de l’étoile. Et en juillet, la Terre s'éloigne de 152 millions de kilomètres du soleil, se rapprochant d'un point appelé aphélie. La distance moyenne est estimée à 150 millions de km.
La Terre se déplace sur son orbite d’ouest en est, ce qui correspond au sens « antihoraire ».
 Il faut à la Terre 365 jours 5 heures 48 minutes 46 secondes (1 année astronomique) pour effectuer une révolution autour du centre du système solaire. Mais pour des raisons de commodité, une année civile compte généralement 365 jours, et le temps restant est « accumulé » et ajoute un jour à chaque année bissextile.
Il faut à la Terre 365 jours 5 heures 48 minutes 46 secondes (1 année astronomique) pour effectuer une révolution autour du centre du système solaire. Mais pour des raisons de commodité, une année civile compte généralement 365 jours, et le temps restant est « accumulé » et ajoute un jour à chaque année bissextile.
La distance orbitale est de 942 millions de km. D'après les calculs, la vitesse de la Terre est de 30 km par seconde ou 107 000 km/h. Pour les personnes, il reste invisible, puisque toutes les personnes et tous les objets se déplacent de la même manière dans le système de coordonnées. Et pourtant, c'est très grand. Par exemple, la vitesse la plus élevée d’une voiture de course est de 300 km/h, ce qui est 365 fois plus lent que la vitesse de la Terre sur son orbite.
Cependant, la valeur de 30 km/s n’est pas constante du fait que l’orbite est une ellipse. La vitesse de notre planète fluctue quelque peu tout au long du voyage. La plus grande différence est obtenue lors du passage des points du périhélie et de l'aphélie et est de 1 km/s. Autrement dit, la vitesse acceptée de 30 km/s est moyenne.
Rotation axiale
L'axe de la Terre est une ligne conventionnelle qui peut être tracée du nord au pôle sud. Elle passe sous un angle de 66°33 par rapport au plan de notre planète. Un tour se produit en 23 heures 56 minutes et 4 secondes, ce temps est désigné par le jour sidéral.
Le principal résultat de la rotation axiale est le changement de jour et de nuit sur la planète. De plus, du fait de ce mouvement :
- La terre a une forme avec des pôles aplatis ;
- les corps (écoulements fluviaux, vent) se déplaçant dans un plan horizontal se déplacent légèrement (dans l'hémisphère sud - vers la gauche, dans l'hémisphère nord - vers la droite).
 La vitesse du mouvement axial dans différentes zones diffère considérablement. La vitesse la plus élevée à l'équateur est de 465 m/s ou 1674 km/h, elle est dite linéaire. C'est la vitesse, par exemple, dans la capitale de l'Équateur. Dans les zones au nord ou au sud de l'équateur, la vitesse de rotation diminue. Par exemple, à Moscou, il est presque 2 fois inférieur. Ces vitesses sont appelées angulaires, leur indicateur diminue à mesure qu'ils se rapprochent des pôles. Aux pôles eux-mêmes, la vitesse est nulle, c'est-à-dire que les pôles sont les seules parties de la planète qui sont immobiles par rapport à l'axe.
La vitesse du mouvement axial dans différentes zones diffère considérablement. La vitesse la plus élevée à l'équateur est de 465 m/s ou 1674 km/h, elle est dite linéaire. C'est la vitesse, par exemple, dans la capitale de l'Équateur. Dans les zones au nord ou au sud de l'équateur, la vitesse de rotation diminue. Par exemple, à Moscou, il est presque 2 fois inférieur. Ces vitesses sont appelées angulaires, leur indicateur diminue à mesure qu'ils se rapprochent des pôles. Aux pôles eux-mêmes, la vitesse est nulle, c'est-à-dire que les pôles sont les seules parties de la planète qui sont immobiles par rapport à l'axe.
C'est l'emplacement de l'axe sous un certain angle qui détermine le changement des saisons. Dans cette position, différentes zones de la planète reçoivent des quantités de chaleur inégales à des moments différents. Si notre planète était située strictement verticalement par rapport au Soleil, il n'y aurait pas de saisons du tout, puisque les latitudes nord éclairées par l'astre pendant la journée recevaient la même quantité de chaleur et de lumière que les latitudes sud.
Les facteurs suivants influencent la rotation axiale :
- changements saisonniers (précipitations, mouvements atmosphériques) ;
- raz de marée dans le sens inverse du mouvement axial.
Ces facteurs ralentissent la planète, ce qui entraîne une diminution de sa vitesse. Le rythme de cette diminution est très faible, seulement 1 seconde en 40 000 ans ; cependant, sur 1 milliard d'années, la journée est passée de 17 à 24 heures.
Le mouvement de la Terre continue d'être étudié à ce jour.. Ces données permettent d'établir des cartes des étoiles plus précises et de déterminer le lien entre ce mouvement et les processus naturels de notre planète.
En astronomie, l'orbite terrestre est le mouvement de la Terre autour du Soleil avec une distance moyenne de 149 597 870 km. La Terre fait complètement le tour du Soleil tous les 365,2563666 jours (1 année sidérale). Dans ce mouvement, le Soleil se déplace par rapport aux étoiles de 1° par jour (ou le diamètre du Soleil ou de la Lune toutes les 12 heures) vers l'est, vu de la Terre. Il faut 24 heures à la Terre pour effectuer une révolution autour de son axe, après quoi le Soleil retourne à son méridien. La vitesse orbitale de la Terre autour du Soleil est en moyenne de 30 km par seconde (108 000 km par heure), ce qui est suffisamment rapide pour parcourir le diamètre de la Terre (environ 12 700 km) en 7 minutes ou la distance jusqu'à la Lune (384 000 km) en 4 minutes. heures.
Lors de l'étude des pôles nord du Soleil et de la Terre, il a été constaté que la Terre tourne par rapport au Soleil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. De plus, le Soleil et la Terre tournent dans le sens antihoraire autour de leurs axes.
L'orbite de la Terre, qui tourne autour du Soleil, parcourt une distance d'environ 940 millions de kilomètres en un an.
Histoire de l'étude
L'héliocentrisme est la théorie selon laquelle le Soleil est au centre du système solaire. Historiquement, l’héliocentrisme contredit le géocentrisme, qui affirme que la Terre est au centre du système solaire. Au XVIe siècle, Nicolas Copernic présenta un ouvrage complet sur le modèle héliocentrique de l'univers, qui ressemblait à bien des égards au modèle géocentrique de Ptolémée Almageste présenté au IIe siècle. Cette révolution copernicienne soutenait que le mouvement rétrograde des planètes n’était qu’apparent et n’était pas évident.
Impact sur Terre
En raison de l'inclinaison de l'axe de la Terre (également connue sous le nom d'inclinaison de l'écliptique), l'inclinaison de la trajectoire du Soleil dans le ciel (telle que vue à la surface de la Terre) varie tout au long de l'année. En observant la latitude nord, lorsque le pôle nord est incliné vers le Soleil, vous pouvez voir que les jours s'allongent et que le Soleil se lève plus haut. Cette situation entraîne une augmentation des températures moyennes à mesure que la quantité de lumière solaire atteignant la surface augmente. Lorsque le pôle nord s’éloigne du soleil, les températures deviennent généralement plus fraîches. Dans les cas extrêmes, lorsque les rayons du soleil n'atteignent pas le cercle polaire arctique, il y a une période d'absence totale de lumière pendant la journée (ce phénomène est appelé nuit polaire). De tels changements climatiques (dus à la direction de l'inclinaison de l'axe de la Terre) se produisent en fonction des saisons.
Événements en orbite
Selon une convention astronomique, les quatre saisons sont déterminées par le solstice, le point orbital avec une inclinaison maximale de l'axe vers ou loin du Soleil, et l'équinoxe, auquel la direction de l'inclinaison et la direction du Soleil sont perpendiculaires l'une à l'autre. autre. Dans l'hémisphère nord, le solstice d'hiver a lieu le 21 décembre, le solstice d'été le 21 juillet, l'équinoxe de printemps le 20 mars et l'équinoxe d'automne le 23 septembre. L'inclinaison de l'axe dans l'hémisphère sud est complètement opposée à sa direction dans l'hémisphère nord. Les saisons du sud sont donc opposées à celles du nord.
Dans les temps modernes, la Terre passe par le périhélie le 3 janvier et par l'aphélie le 4 juillet (pour les autres époques, voir précession et cycles de Milankovitch). Le changement de direction de la Terre et du Soleil entraîne une augmentation de 6,9 % de l’énergie solaire qui atteint la Terre au périhélie par rapport à l’aphélie. Étant donné que l’hémisphère sud s’incline vers le soleil à peu près au même moment où la Terre atteint son point le plus proche du soleil, au cours d’une année, l’hémisphère sud reçoit légèrement plus d’énergie solaire que l’hémisphère nord. Cependant, cet effet est moins important que le changement global d'énergie dû à l'inclinaison de l'axe : la majeure partie de l'énergie reçue est absorbée par les eaux de l'hémisphère sud.
La sphère de Hill (sphère d'influence gravitationnelle) de la Terre a un rayon de 1 500 000 kilomètres. Il s'agit de la distance maximale à laquelle l'influence gravitationnelle de la Terre est plus forte que celle des planètes plus éloignées et du Soleil. Les objets en orbite autour de la Terre doivent se trouver dans ce rayon, sinon ils pourraient se détacher en raison de la perturbation gravitationnelle du Soleil.
Le diagramme suivant montre la relation entre la ligne du solstice et la ligne asp de l'orbite elliptique de la Terre. L'ellipse orbitale (l'excentricité est exagérée pour l'effet) est représentée sur six images de la Terre au périhélie (périapsis - le point le plus proche du Soleil) du 2 au 5 janvier : l'équinoxe de mars du 20 au 21 mars, le point du solstice de juin du 20 au 21 juin, on peut également voir ici l'aphélie (apocentre - le point le plus éloigné du Soleil) du 4 au 7 juillet, l'équinoxe de septembre du 22 au 23 septembre et le solstice de décembre du 21 au 22 décembre. Notez que le diagramme montre une forme exagérée de l’orbite terrestre. En réalité, la trajectoire de l’orbite terrestre n’est pas aussi excentrique que le montre le diagramme.
Le monde mystérieux et magique de l’astronomie attire l’attention de l’humanité depuis l’Antiquité. Les gens ont levé la tête vers le ciel étoilé et ont posé des questions éternelles sur pourquoi les étoiles changent de position, pourquoi le jour et la nuit viennent, pourquoi quelque part un blizzard hurle, et quelque part dans le désert il fait plus 50...
Mouvement des luminaires et des calendriers
La plupart des planètes du système solaire tournent autour d’elles-mêmes. En même temps, ils font tous des révolutions autour du Soleil. Certains le font rapidement et rapidement, d’autres lentement et solennellement. La planète Terre ne fait pas exception : elle se déplace constamment dans l’espace. Même dans les temps anciens, les gens, ne connaissant pas les raisons et le mécanisme de ce mouvement, remarquèrent un certain schéma général et commencèrent à compiler des calendriers. Même alors, l'humanité s'intéressait à la question de savoir à quelle vitesse la Terre tourne autour du Soleil.
Le soleil se lève au lever du soleil

Le mouvement de la Terre autour de son axe est le jour terrestre. Et le passage complet de notre planète sur une orbite ellipsoïdale autour de l'étoile est une année civile.
Si vous vous placez au pôle Nord et dessinez un axe imaginaire passant par la Terre jusqu'au pôle Sud, il s'avère que notre planète se déplace d'ouest en est. Rappelez-vous, dans « Le Conte de la campagne d'Igor », il est dit que « Le soleil se lève au lever du soleil » ? L'Orient reçoit toujours les rayons du soleil avant l'Occident. C'est pourquoi le Nouvel An commence plus tôt en Extrême-Orient qu'à Moscou.
Dans le même temps, les scientifiques ont déterminé que seuls deux points de notre planète sont dans une position statique par rapport aux pôles Nord et Sud.
Vitesse folle
Tous les autres endroits de la planète sont en perpétuel mouvement. Quelle est la vitesse de révolution de la Terre autour du Soleil ? A l'équateur, elle est la plus élevée et atteint 1670 km/h. Plus près des latitudes moyennes, par exemple en Italie, la vitesse est déjà beaucoup plus faible - 1 200 km par heure. Et plus on est proche des pôles, plus il est de plus en plus petit.
La période de rotation de la Terre autour de son axe est de 24 heures. C'est ce que disent les scientifiques. Nous appelons cela plus simple : un jour.
A quelle vitesse la Terre tourne-t-elle autour du Soleil ?
350 fois plus rapide qu'une voiture de course
En plus de tourner autour de son axe, la Terre effectue également un mouvement elliptique autour d’une étoile appelée Soleil. À quelle vitesse les scientifiques calculent depuis longtemps cet indicateur à l'aide de formules et de calculs complexes. La vitesse de révolution de la Terre autour du Soleil est de 107 000 kilomètres par heure.
Il est difficile d’imaginer ces chiffres fous et irréalistes. Par exemple, même la voiture la plus course - 300 kilomètres par heure - est 356 fois inférieure à la vitesse de la Terre en orbite.
Il nous semble qu'elle monte et monte, que la Terre est immobile et que l'astre fait un cercle dans le ciel. Pendant très longtemps, l’humanité a pensé exactement ainsi, jusqu’à ce que les scientifiques prouvent que tout se passe dans l’autre sens. Aujourd'hui, même un écolier sait ce qui se passe dans le monde : les planètes se déplacent en douceur et solennellement autour du Soleil, et non l'inverse. La Terre tourne autour du Soleil, et pas du tout comme le croyaient les anciens.

Ainsi, nous avons découvert que la vitesse de rotation de la Terre autour de son axe et du Soleil est respectivement de 1 670 km par heure (à l'équateur) et de 107 000 kilomètres par heure. Wow, nous volons !
Année solaire et sidérale
Cercle complet, ou plutôt ovale ellipsoïdal, la planète Terre fait le tour du Soleil en 356 jours 5 heures 48 minutes 46 secondes. Les astronomes appellent ces chiffres « l’année astrologique ». Ainsi, à la question « Quelle est la fréquence de révolution de la Terre autour du Soleil ? nous répondons simplement et succinctement : « Un an ». Cet indicateur reste inchangé, mais pour une raison quelconque, tous les quatre ans, nous avons une année bissextile au cours de laquelle il y a un jour de plus.
C'est juste que les astronomes conviennent depuis longtemps que les 5 heures et les « kopecks » supplémentaires ne sont pas comptés chaque année, mais ont choisi le numéro de l'année astronomique, qui est un multiple du jour. Ainsi, une année compte 365 jours. Mais pour qu'il n'y ait pas d'échec au fil du temps, pour que les rythmes naturels ne changent pas dans le temps, une fois tous les quatre ans, un jour supplémentaire apparaît dans le calendrier de février. Sur une période de 4 ans, ces quarts de jours « se rassemblent » en une journée complète - et nous célébrons une année bissextile. Ainsi, pour répondre à la question de savoir quelle est la fréquence de révolution de la Terre autour du Soleil, n’hésitez pas à dire un an.
Dans le monde scientifique, il existe les concepts d'« année solaire » et d'« année sidérale (sidérale) ». La différence entre eux est d'environ 20 minutes et cela est dû au fait que notre planète se déplace plus rapidement sur son orbite que le Soleil ne revient à l'endroit que les astronomes ont déterminé comme le point de l'équinoxe de printemps. Nous connaissons déjà la vitesse de révolution de la Terre autour du Soleil, et la période complète de révolution de la Terre autour du Soleil est de 1 an.

Jours et années sur d'autres planètes
Les neuf planètes du système solaire ont leurs propres « concepts » sur la vitesse, ce qu'est un jour et ce qu'est une année astronomique.
La planète Vénus, par exemple, tourne sur elle-même en 243 jours terrestres. Pouvez-vous imaginer tout ce que vous pouvez faire là-bas en une journée ? Et combien de temps dure la nuit ?
Mais sur Jupiter, c’est le contraire. Cette planète tourne autour de son axe à une vitesse gigantesque et parvient à tourner à 360 degrés en 9,92 heures.
La vitesse orbitale de la Terre autour du Soleil est d'un an (365 jours), mais celle de Mercure n'est que de 58,6 jours terrestres. Sur Mars, la planète la plus proche de la Terre, la journée dure presque aussi longtemps que sur Terre - 24 heures et demie, mais l'année est presque deux fois plus longue - 687 jours.
La révolution de la Terre autour du Soleil est de 365 jours. Multiplions maintenant ce chiffre par 247,7 et obtenons un an sur la planète Pluton. Un millénaire s'est écoulé pour nous, mais seulement quatre ans se sont écoulés sur la planète la plus éloignée du système solaire.
Ce sont des valeurs paradoxales et des chiffres effrayants par leur ampleur.
Ellipse mystérieuse

Pour comprendre pourquoi les saisons changent périodiquement sur la planète Terre, pourquoi il fait froid ici dans la zone médiane en hiver, il est important non seulement de répondre à la question de savoir à quelle vitesse la Terre tourne autour du Soleil et sur quel chemin. Il est également nécessaire de comprendre comment il procède.
Et elle ne le fait pas en cercle, mais en ellipse. Si nous traçons l'orbite de la Terre autour du Soleil, nous verrons qu'elle est la plus proche du soleil en janvier et la plus éloignée en juillet. Le point le plus proche de l’orbite terrestre est appelé périhélie et le point le plus éloigné est appelé aphélie.
Étant donné que l'axe de la Terre n'est pas dans une position strictement verticale, mais est incliné d'environ 23,4 degrés et que l'angle d'inclinaison par rapport à l'orbite ellipsoïdale augmente jusqu'à 66,3 degrés, il s'avère que dans différentes positions, la Terre expose différents côtés au Soleil.
En raison de l'inclinaison de l'orbite, la Terre se tourne vers l'étoile aux hémisphères différents, d'où le changement de temps. Lorsque l’hiver fait rage dans l’hémisphère nord, l’été chaud s’épanouit dans l’hémisphère sud. Six mois passeront et la situation changera exactement à l'opposé.
Tourne, luminaire terrestre !
Le Soleil tourne-t-il autour de quelque chose ? Bien sûr! Il n’existe pas d’objets absolument immobiles dans l’espace. Toutes les planètes, tous leurs satellites, toutes les comètes et astéroïdes tournent comme sur des roulettes. Bien sûr, différents corps célestes ont des vitesses de rotation et des angles d'inclinaison de leurs axes différents, mais ils sont toujours en mouvement. Et le Soleil, qui est une étoile, ne fait pas exception.

Le système solaire n’est pas un espace clos indépendant. Elle fait partie d’une immense galaxie spirale appelée la Voie Lactée. Elle ne comprend à son tour pas moins de 200 milliards d’étoiles supplémentaires. Le soleil se déplace en cercle par rapport au centre de cette galaxie. Les scientifiques ont également calculé la vitesse de rotation du Soleil autour de l'axe et de la Voie lactée à l'aide d'observations à long terme et de formules mathématiques.
Aujourd'hui, de telles données sont disponibles. Le Soleil achève son cycle complet de mouvement circulaire autour de la Voie lactée en 226 millions d'années. En science astronomique, ce chiffre est appelé « année galactique ». De plus, si nous imaginons la surface de la galaxie comme plate, alors notre étoile effectue de légères oscillations, de haut en bas, apparaissant alternativement dans les hémisphères nord et sud de la Voie lactée. La fréquence de ces fluctuations est de 30 à 35 millions d'années.
Les scientifiques pensent que le Soleil a réussi à faire 30 tours complets autour de la Voie lactée au cours de l'existence de la Galaxie. Ainsi, le Soleil n’a vécu jusqu’à présent que 30 années galactiques. C’est en tout cas ce que disent les scientifiques.
La plupart des scientifiques pensent que la vie sur Terre a commencé il y a 252 millions d’années. Ainsi, on peut affirmer que les premiers organismes vivants sur Terre sont apparus lorsque le Soleil a effectué sa 29e révolution autour de la Voie lactée, c'est-à-dire au cours de la 29e année de sa vie galactique.
Le corps et les gaz se déplacent à des vitesses différentes

Nous avons appris beaucoup de faits intéressants. Nous connaissons déjà la vitesse de révolution de la Terre autour du Soleil, nous avons découvert quelle est l'année astronomique et galactique, à quelle vitesse la Terre et le Soleil se déplacent sur leurs orbites, et maintenant nous allons déterminer à quelle vitesse le Soleil tourne autour de son axe.
Le fait que le Soleil tourne a été remarqué par des chercheurs anciens. Des taches similaires apparaissaient et disparaissaient périodiquement, ce qui conduisait à la conclusion qu'il tournait autour d'un axe. Mais à quelle vitesse ? Les scientifiques, disposant des méthodes de recherche les plus modernes, en ont discuté pendant très longtemps.
Après tout, notre étoile a une composition très complexe. Son corps est un liquide solide. À l’intérieur se trouve un noyau solide autour duquel se trouve un manteau de liquide chaud. Au-dessus se trouve une croûte dure. De plus, la surface du Soleil est enveloppée de gaz chauds, qui brûlent constamment. C'est un gaz lourd constitué principalement d'hydrogène.
Ainsi, le corps du Soleil lui-même tourne lentement, mais ce gaz brûlant tourne rapidement.
25 jours et 22 ans
La coque externe du Soleil effectue une rotation complète autour de son axe en 27 jours et demi. Les astronomes ont pu le déterminer en observant les taches solaires. Mais c'est la moyenne. Par exemple, à l’équateur, ils tournent plus vite et tournent autour de leur axe en 25 jours. Aux pôles, les spots se déplacent à une vitesse de 31 à 36 jours.
Le corps de l'étoile elle-même tourne autour de son axe en 22,14 ans. En général, sur cent ans de vie terrestre, le Soleil ne tournera autour de son axe que quatre fois et demie.
Pourquoi les scientifiques étudient-ils avec autant de précision la vitesse de rotation de notre étoile ?
Parce qu’il apporte des réponses à de nombreuses questions évolutives. Après tout, l’étoile Soleil est la source de vie pour toute vie sur Terre. C’est grâce aux éruptions solaires, comme le pensent de nombreux chercheurs, que la vie est apparue sur Terre (il y a 252 millions d’années). Et c’est précisément à cause du comportement du Soleil que les dinosaures et autres reptiles sont morts dans l’Antiquité.
Brille de mille feux sur nous, Soleil !
Les gens se demandent constamment si le Soleil va épuiser son énergie et s’éteindre ? Bien sûr, cela s'éteindra - rien n'est éternel au monde. Et pour des étoiles aussi massives, il y a un moment de naissance, d’activité et de décomposition. Mais pour l’instant, le Soleil est au milieu de son cycle évolutif et il dispose de suffisamment d’énergie. À propos, au tout début, cette étoile était moins brillante. Les astronomes ont déterminé qu’au cours des premiers stades de développement, la luminosité du Soleil était 70 % inférieure à ce qu’elle est aujourd’hui.
Pour un observateur situé dans l'hémisphère nord, par exemple dans la partie européenne de la Russie, le Soleil se lève généralement à l'est et se lève vers le sud, occupant la position la plus élevée du ciel à midi, puis s'incline vers l'ouest et disparaît derrière. l'horizon. Ce mouvement du Soleil est uniquement visible et est provoqué par la rotation de la Terre autour de son axe. Si vous regardez la Terre d’en haut en direction du pôle Nord, elle tournera dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Dans le même temps, le Soleil reste en place, l'apparence de son mouvement est créée en raison de la rotation de la Terre.
Rotation annuelle de la Terre
La Terre tourne également dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du Soleil : si vous regardez la planète d'en haut, depuis le pôle Nord. Parce que l’axe de la Terre est incliné par rapport à son plan de rotation, il l’éclaire de manière inégale lorsque la Terre tourne autour du Soleil. Certaines zones reçoivent plus de soleil, d’autres moins. Grâce à cela, les saisons changent et la durée du jour change.
Equinoxe de printemps et d'automne
Deux fois par an, le 21 mars et le 23 septembre, le Soleil éclaire également les hémisphères nord et sud. Ces moments sont connus sous le nom d’équinoxe d’automne. En mars, l'automne commence dans l'hémisphère nord et l'automne dans l'hémisphère sud. En septembre, au contraire, l'automne arrive dans l'hémisphère nord et le printemps dans l'hémisphère sud.
Solstice d'été et d'hiver
Dans l’hémisphère Nord, le 22 juin, le Soleil se lève au plus haut de l’horizon. Le jour a la durée la plus longue et la nuit ce jour-là est la plus courte. Le solstice d'hiver a lieu le 22 décembre : le jour a la durée la plus courte et la nuit la plus longue. Dans l’hémisphère Sud, c’est le contraire qui se produit.
nuit polaire
En raison de l'inclinaison de l'axe de la Terre, les régions polaires et subpolaires de l'hémisphère Nord sont dépourvues de soleil pendant les mois d'hiver : le Soleil ne s'élève pas du tout au-dessus de l'horizon. Ce phénomène est connu sous le nom de nuit polaire. Une nuit polaire similaire existe pour les régions circumpolaires de l'hémisphère sud, la différence entre elles étant d'exactement six mois.
Qu'est-ce qui donne à la Terre sa rotation autour du Soleil
Les planètes ne peuvent s’empêcher de tourner autour de leurs étoiles, sinon elles seraient simplement attirées et brûlées. La particularité de la Terre réside dans le fait que son inclinaison d’axe de 23,44° s’est avérée optimale pour l’émergence de toute la diversité de la vie sur la planète.
C'est grâce à l'inclinaison de l'axe que les saisons changent, il existe différentes zones climatiques qui assurent la diversité de la flore et de la faune terrestre. Les modifications du réchauffement de la surface terrestre assurent le mouvement des masses d'air, et donc des précipitations sous forme de pluie et de neige.
La distance de la Terre au Soleil de 149 600 000 km s'est également avérée optimale. Un peu plus loin, l’eau sur Terre ne serait que sous forme de glace. Plus on s'approche et plus la température est déjà trop élevée. L’émergence même de la vie sur Terre et la diversité de ses formes sont devenues possibles précisément grâce à la coïncidence unique de nombreux facteurs.
L’homme considère la Terre comme plate, mais il est établi depuis longtemps qu’elle est une sphère. Les gens se sont mis d’accord pour appeler ce corps céleste une planète. D'où vient ce nom ?
Les astronomes de la Grèce antique, qui ont observé le comportement des corps célestes, ont introduit deux termes avec des significations opposées : planètes asteres - « étoiles » - corps célestes semblables à des étoiles, se déplaçant partout ; asteres aplanis - "étoiles fixes" - corps célestes qui sont restés immobiles tout au long de l'année. Dans les croyances des Grecs, la Terre était immobile et située au centre, ils l'ont donc classée comme une "étoile fixe". Les Grecs connaissaient Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, visibles à l'œil nu, mais ils ne les appelaient pas « planètes », mais « errantes ». Dans la Rome antique, les astronomes appelaient déjà ces corps « planètes », ajoutant à cela le Soleil et la Lune. L'idée d'un système à sept planètes a survécu jusqu'au Moyen Âge. Au XVIe siècle, Nicolas Copernic a changé son point de vue sur l'appareil, remarquant son héliocentricité. La Terre, autrefois considérée comme le centre du monde, a été réduite à la position d'une des planètes tournant autour du Soleil. En 1543, Copernic publia son ouvrage intitulé « Sur les révolutions des sphères célestes », dans lequel il exprima son point de vue. Malheureusement, l'Église n'a pas apprécié le caractère révolutionnaire des vues de Copernic : son triste sort est connu. D'ailleurs, selon Engels, la « libération des sciences naturelles de la théologie » commence sa chronologie précisément avec l'ouvrage publié de Copernic. Ainsi, Copernic a remplacé le système géocentrique du monde par un système héliocentrique. Le nom « planète » est resté associé à la Terre. La définition d’une planète, en général, a toujours été ambiguë. Certains astronomes soutiennent que la planète doit être assez massive, tandis que d'autres considèrent cela comme une condition facultative. Si nous abordons la question de manière formelle, la Terre peut être appelée en toute sécurité une planète, ne serait-ce que parce que le mot « planète » lui-même vient du grec ancien planis, qui signifie « mobile », et que la science moderne n'a aucun doute sur la mobilité de la Terre.
"Et pourtant, elle tourne !" – nous connaissons cette phrase encyclopédique, prononcée par le physicien et astronome du passé Galileo Galilei, depuis nos années d'école. Mais pourquoi la Terre tourne-t-elle ? En fait, cette question est souvent posée par leurs parents lorsqu’ils étaient jeunes enfants, et les adultes eux-mêmes n’hésitent pas à comprendre les secrets de la rotation de la Terre.

Pour la première fois, un scientifique italien a évoqué le fait que la Terre tourne autour de son axe dans ses travaux scientifiques au début du XVIe siècle. Mais il y a toujours eu beaucoup de controverses au sein de la communauté scientifique sur la nature de la rotation. L’une des théories les plus courantes affirme que dans le processus de rotation de la Terre, d’autres processus ont joué un rôle majeur – ceux qui ont eu lieu dans des temps immémoriaux, à l’époque de l’éducation. Des nuages de poussière cosmique « se sont rassemblés », et ainsi les « embryons » de planètes se sont formés. Ensuite, d’autres corps cosmiques – grands et plus petits – ont été « attirés ». Ce sont précisément les collisions avec les grandes planètes célestes, selon un certain nombre de scientifiques, qui déterminent la rotation constante des planètes. Et puis, selon la théorie, ils ont continué à tourner par inertie. Certes, si l’on prend en compte cette théorie, de nombreuses questions naturelles se posent. Pourquoi y a-t-il six planètes dans le système solaire qui tournent dans un sens et une autre, Vénus, dans le sens opposé ? Pourquoi la planète Uranus tourne-t-elle de telle manière qu'il n'y a aucun changement d'heure sur cette planète ? Pourquoi la vitesse de rotation de la Terre peut-elle changer (légèrement, bien sûr, mais quand même) ? Les scientifiques n’ont pas encore répondu à toutes ces questions. On sait que la Terre a tendance à ralentir quelque peu sa rotation. Chaque siècle, le temps nécessaire pour effectuer une rotation complète autour d'un axe augmente d'environ 0,0024 seconde. Les scientifiques attribuent cela à l'influence du satellite de la Terre, la Lune. Eh bien, à propos des planètes du système solaire, on peut dire que la planète Vénus est considérée comme la « plus lente » en termes de rotation, et Uranus est la plus rapide.
Sources:
- Tous les six ans, la Terre tourne plus vite - Naked Science
Elle est sphérique, mais ce n’est pas une balle parfaite. En raison de la rotation, la planète est légèrement aplatie aux pôles ; une telle figure est généralement appelée sphéroïde ou géoïde - "comme la terre".
La terre est immense, sa taille est difficile à imaginer. Les principaux paramètres de notre planète sont les suivants :
- Diamètre - 12570 km
- Longueur de l'équateur - 40076 km
- La longueur d'un méridien est de 40 008 km.
- La superficie totale de la Terre est de 510 millions de km2
- Rayon des pôles - 6357 km
- Rayon de l'équateur - 6378 km
La Terre tourne simultanément autour du Soleil et autour de son propre axe.
La Terre tourne autour d'un axe incliné d'ouest en est. La moitié du globe est éclairée par le soleil, il y fait jour à cette heure-là, l'autre moitié est dans l'ombre, là il fait nuit. En raison de la rotation de la Terre, le cycle du jour et de la nuit se produit. La Terre fait une révolution autour de son axe en 24 heures – par jour.
En raison de la rotation, les courants en mouvement (rivières, vents) sont déviés dans l'hémisphère nord vers la droite et dans l'hémisphère sud vers la gauche.
Rotation de la Terre autour du Soleil
La Terre tourne autour du Soleil sur une orbite circulaire, effectuant un tour complet en 1 an. L'axe de la Terre n'est pas vertical, il est incliné d'un angle de 66,5° par rapport à l'orbite, cet angle reste constant pendant toute la rotation. La principale conséquence de cette rotation est le changement des saisons.
Considérons les points extrêmes de la rotation de la Terre autour du Soleil.

- 22 décembre- solstice d'hiver. Le tropique sud est actuellement le plus proche du soleil (le soleil est à son zénith) - c'est donc l'été dans l'hémisphère sud et l'hiver dans l'hémisphère nord. Les nuits dans l'hémisphère sud sont courtes : le 22 décembre, dans le cercle polaire sud, le jour dure 24 heures, la nuit ne vient pas. Dans l'hémisphère nord, c'est l'inverse ; dans le cercle polaire arctique, la nuit dure 24 heures.
- 22 juin- jour du solstice d'été. Le tropique nord est le plus proche du soleil ; c'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Dans le cercle polaire sud, la nuit dure 24 heures, mais dans le cercle nord, il n'y a pas de nuit du tout.
- 21 mars, 23 septembre- jours des équinoxes de printemps et d'automne L'équateur est le plus proche du soleil, le jour est égal à la nuit dans les deux hémisphères.