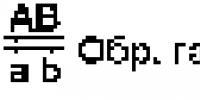Carnet pour les travaux de laboratoire. Caractéristiques générales de la classe des mammifères
Travail de laboratoire n°3
sur le thème : « Etude de la structure externe d'un mammifère »
Objectif du travail : étudier les caractéristiques de la structure externe des représentants de la classe Mammifères.
Équipement: squelette d'un mammifère, tableaux et dessins représentant des mammifères, présentation « Caractéristiques structurelles des mammifères ».
Progrès:
Étudiez le plan corporel général des mammifères.
Étudiez les caractéristiques de la structure externe des mammifères. Familiarisez-vous avec les caractéristiques structurelles de la racine des cheveux.
Énumérez quels organes se trouvent sur la tête d'un mammifère ? Quelle importance ont-ils pour les mammifères ?



Établir les fonctions caractéristiques de chaque type de poils recouvrant le corps des mammifères. Pour ce faire, utilisez les données ci-dessous. Reflétez les résultats dans le tableau.
1. Poils de garde longs, forts et grossiers.
2. Sous-poil ou sous-poil - poils doux, épais et courts.
3. Poils longs, gros et sensoriels, à la base desquels se trouvent des fibres nerveuses qui détectent le contact avec des corps étrangers.
A. Remplir la fonction des organes du toucher.
B. Ils retiennent bien la chaleur, car beaucoup d’air est emprisonné entre ce type de cheveux.
B. Protège la peau des dommages.
3. Familiarisez-vous avec la variété des formes corporelles des différents représentants de la classe Mammifères.
Nommez les animaux représentés sur les images et sélectionnez parmi les options proposées celles qui caractérisent la forme de leur corps. Déterminez à quelles conditions de vie leurs différentes formes corporelles sont adaptées.

A B C D

![]()
![]()
![]()
1 2 3 4
![]()
![]()
6 7 8
4. Étudier les caractéristiques structurelles du squelette des mammifères, étudier le squelette axial, le squelette des membres.
Identifiez les principaux éléments du squelette des mammifères (Fig. A).
Indiquez de quelles parties est constituée la colonne vertébrale du mammifère (Fig. B).
Indiquez de quelles parties est constitué le squelette des membres antérieurs des mammifères (Fig. B).
Indiquez de quelles parties est constitué le squelette des membres postérieurs des mammifères (Fig. D).


UN B


VG
5. Tirez une conclusion du travail effectué.
Atelier laboratoire sur le thème « Mammifères »
Nous avons analysé des programmes de biologie de différents auteurs : N.I. Sonina, I.N. Ponomareva, V.V. Apiculteur.
D'après le programme édité par N.I. Sonin dans la section « Mammifères ou Animaux » contient deux travaux de laboratoire : « Détermination de l'appartenance des mammifères à des ordres », « Identification des adaptations des mammifères à leur environnement ». Ils sont réalisés en une seule leçon.
D'après le programme édité par I.N. Ponomareva compte quatre travaux de laboratoire : « Etude de la structure externe d'un mammifère », « Etude de la structure interne d'un mammifère », « Identification des adaptations des mammifères à l'environnement », « Reconnaissance des animaux domestiques ».
D'après le programme édité par V.V. L'apiculteur dispose de deux travaux de laboratoire : « Etude de la structure externe des mammifères », « Identification des caractéristiques structurelles des mammifères en lien avec le mode de vie ». Ils sont réalisés en une seule leçon.
Les cours de laboratoire désignent tout type d'activité indépendante des étudiants. La position la plus claire et la plus motivée sur cette question est prise par V.F. Shalaev, V.A. Tetyurev, B.V. Vsesvyatsky et V.N. Fedorov. Reconnaissant les cours de laboratoire comme une forme organisationnelle indépendante du processus éducatif, ils soulignent les caractéristiques suivantes :
1. Les cours se déroulent dans des conditions de salle de classe ou de laboratoire
2. Les élèves travaillent de manière autonome, en utilisant des méthodes d'observation et d'expérimentation
3. L'enseignant dirige et contrôle le travail des élèves.
Les caractéristiques énumérées ne révèlent pas les différences entre les cours de laboratoire et les autres formes de processus pédagogique, puisqu'elles ne révèlent pas les spécificités des observations réalisées dans ces classes. Tout d'abord, les observations sont réalisées aussi bien lors d'excursions que lors de démonstrations des animaux étudiés (en illustrations, mannequins, peluches) ; Deuxièmement, toutes les observations indépendantes de l'objet étudié par les étudiants ne sont pas typiques des cours de laboratoire.
L'expérience pédagogique montre que dans l'enseignement de la biologie, il convient de distinguer deux types d'observations :
1. Observation contemplative, c'est-à-dire sans affecter l'objet étudié,
2. Observation efficace, c'est-à-dire accompagné d'un impact sur l'objet d'étude.
Par exemple, l'observation contemplative dans le processus d'étude des mammifères est réalisée lors de l'examen de l'apparence des animaux, dans le cadre d'observations phénologiques de la vie des animaux.
Une observation efficace lors de l'étude des mammifères est effectuée lors de l'examen de la structure interne et du squelette, des cheveux, lorsque les élèves effectuent des actions avec des mannequins, peuvent les démonter, examiner des pièces individuelles. La structure de la racine des cheveux peut être examinée au microscope. Sans aucun doute, l'observation contemplative en tant que méthode de travail indépendant est importante dans l'enseignement de la biologie : les étudiants perçoivent directement et délibérément les caractéristiques distinctives de l'objet naturel étudié, bien qu'ils ne l'influencent pas. À la suite de telles observations, les élèves développent des perceptions, des idées et des concepts sur les phénomènes et les objets naturels observés, par exemple lors d'excursions dans la nature, lors de cours en classe lorsqu'ils travaillent avec des documents naturels, ainsi que lorsque l'enseignant démontre des expériences et des objets. en cours d'étude.
Nous examinerons ensuite les principales méthodes et techniques permettant de mener des travaux de laboratoire. Les principales méthodes de réalisation d'un travail indépendant sont l'observation, les expériences sur les animaux et les travaux pratiques. Nous parlons de travail en laboratoire et non de travail indépendant.
La réalisation d'observations indépendantes garantit une activité étudiante et un intérêt supplémentaire lors de l'étude du sujet de la biologie.
Les connaissances acquises grâce à l’observation se distinguent généralement par leur clarté et leur force. Au cours de ses propres observations lors de l'exécution de travaux de laboratoire, un intérêt pour l'étude des animaux se développe, l'initiative, la précision et la responsabilité du travail effectué sont cultivées.
Les étudiants, effectuant des travaux de laboratoire, maîtrisent les compétences et les méthodes scientifiques d'étude du monde animal. Par conséquent, une attention particulière doit être accordée à l'observation indépendante des étudiants lors des travaux de laboratoire en biologie.
Expériences avec des animaux
En utilisant l'expérience comme méthode d'apprentissage, les étudiants apprennent par la pratique cette méthode importante de recherche scientifique et la maîtrisent progressivement. Tout cela pose une tâche au professeur de zoologie : utiliser, dans la mesure du possible, le travail expérimental indépendant des étudiants, y compris des observations et des expériences sur des animaux.
Travaux pratiques des étudiants
La combinaison du travail physique avec l'étude des animaux est la plus caractéristique de cette méthode. Les travaux pratiques des étudiants avec les animaux peuvent, dans une certaine mesure, être considérés comme un travail pédagogique et cognitif. Par conséquent, en plus de sa valeur matérielle, il a également une grande valeur éducative : il apprend aux enfants à travailler, leur inculque l'amour du travail physique et les prépare à des activités pratiques après avoir quitté l'école.
Pour organiser les activités des étudiants lors de la réalisation de travaux de laboratoire, il est conseillé de les diviser en groupes (les petits groupes sont composés de 3 à 5 personnes). Chaque groupe d'étudiants reçoit une fiche de travail avec une illustration du type d'adaptation des organismes étudiés et une présentation des informations problématiques, un texte de formation, une tâche et un algorithme pour réaliser la partie pratique. Le contenu des fiches de travail proposées permet non seulement de créer une situation problématique, mais aussi d'organiser les activités des étudiants pour comprendre la problématique de recherche, rechercher des informations pédagogiques et tester des hypothèses, obtenir, discuter et résumer les résultats obtenus et stimuler l'activité réflexive. des étudiants.
Dans le processus d'étude des mammifères, les supports pédagogiques suivants peuvent être utilisés :
· Tableaux « Type Chordata. Classe Mammifères".
· Modèle de « Structure du crâne », « Structure du squelette ».
· Médias électroniques : manuel illustré, maquettes interactives - le déplacement des reptiles.
· Photographies de mammifères.
· Dessins et diagrammes.
· Questions et tâches de complexité variable sur le sujet de la leçon.
Lors des travaux de laboratoire, des instruments à usage général sont utilisés : unité de mesure informatique, pouls, respiration, capteur de température ; préparations (éprouvettes) : édentées, structure interne d'un rat, tétras, grenouille, trion, couleuvre, vipère, carassin, etc. Des modèles de squelettes, des mannequins, des instruments de laboratoire : des microscopes pédagogiques, un kit de microscopie, un appareil de comparaison du dioxyde de carbone dans l'air inhalé et expiré, etc.
A titre d'exemple de travaux de laboratoire à caractère problématique de recherche, citons les travaux de la rubrique « Mammifères » sur le thème « Identification de l'adaptabilité des organismes à leur environnement ».
Les objectifs de ce travail de laboratoire sont les suivants :
· Créer les conditions permettant aux étudiants de comprendre les concepts d'« adaptabilité », d'« opportunité », d'« adaptation », de « relativité de l'aptitude » ;
· Développer l'intérêt pour l'information éducative et scientifique concernant le problème de la diversité des caractéristiques adaptatives chez les mammifères ;
· Formation des compétences des étudiants pour appliquer les connaissances sur les modèles évolutifs de l'apparition de l'adaptation pour expliquer le mécanisme d'apparition d'une adaptation spécifique, pour prédire les conséquences et formuler des conclusions.
Une approche par problèmes de l'étude du contenu éducatif crée les conditions permettant aux étudiants de proposer des hypothèses, des versions, des arguments et de généraliser des faits individuels dans le contexte de l'image globale d'événements ou de processus ; prouver leur validité ou les rejeter. En recherchant des informations sur les problèmes étudiés, les étudiants sont amenés à des conclusions et à des généralisations indépendantes.
La présentation de la situation problématique se termine par les questions et tâches suivantes : Selon vous, quel est le problème ici et comment formuleriez-vous la question problématique ? Formulez une hypothèse pour expliquer cette contradiction. Comment vérifieriez-vous la véracité de votre propre jugement ?
Il est suggéré de : Considérer attentivement les objets d'étude (matériel naturel et/ou illustratif) Déterminer les conditions environnementales qui provoquent l'apparition d'adaptations spécifiques dans les objets. Décrire les traits caractéristiques des objets étudiés qui contribuent à leur adaptation aux conditions environnementales. En utilisant vos connaissances sur les forces motrices de l'évolution et les modèles génétiques de base, les informations analysées ainsi que vos propres observations, décrivez le chemin possible d'émergence de caractéristiques d'adaptation spécifiques.
Évaluez la faisabilité d’adapter les objets de recherche aux conditions environnementales et justifiez votre opinion.
À la fin des travaux de laboratoire, les discussions entre tous les étudiants de la classe sur une tâche problématique pour chaque groupe, dont les solutions peuvent également être résolues par les étudiants d'autres groupes, revêtent une importance particulière.
Travaux de laboratoire sur le thème : « Squelette de mammifère ».
Objectif : étudier les caractéristiques structurelles du squelette des mammifères.
Équipements et matériels :
1. Squelette de lapin, de chat ou de rat (un pour deux élèves).
2. Vertèbres de différentes parties du corps (une pour deux élèves).
3. Membres antérieurs et postérieurs avec ceintures (une pour deux élèves).
4. Crânes d'insectivores, rongeurs, carnivores, ongulés (un pour deux élèves).
5. Tableaux : 1. squelette d'un mammifère ; 2. la structure des vertèbres de différentes parties du corps ; 3. crâne (vue latérale et inférieure) ; 3. Squelette des membres et de leurs ceintures.
Crâne cérébral
Région occipitale : os occipital ; foramen magnum; condyles occipitaux.
Côtés du crâne : os squamosaux avec apophyses zygomatiques ; zygomatique; maxillaire; intermaxillaire (prémaxillaire); lacrymal; oculocuneiforme; os ptérygosphénoïdes.
Toit du crâne : pariétal ; interpariétal; frontale; os nasaux.
Plancher du crâne : sphénoïde basique ; en forme de coin antérieur ; rocheux; ptérygoïde; palatins; processus palatins des os maxillaires; labyrinthes en treillis; vomer; os tympanique; choanes; ouvertures pour les sorties des nerfs, des vaisseaux sanguins et de la trompe d'Eustache.
Crâne viscéral
Mâchoire inférieure : dentaires avec processus coronoïdes, articulaires et angulaires.
Colonne vertébrale
Sections de la colonne vertébrale : cervicale, thoracique, lombaire, sacrée caudale.
La structure de la vertèbre platycélium du tronc, de l'atlas et de l'épistrophée.
Poitrine : vraies et fausses côtes ; sternum (manubrium et processus xiphoïde).
Ceintures de membres
Membre antérieur : épaule ; avant-bras (radius et cubitus); main (poignet, métacarpe, phalanges).
Membre postérieur : cuisse ; tibia (tibia et péroné); pied (tarse, métatarse, phalanges).
Esquisser:
Crâne (vues de côté et de dessous)
Travaux de laboratoire
Matière : Biologie cours : 7 Numéro de cours : 57 date :
Sujet: Caractéristiques générales de la classe. Habitats des mammifères. Caractéristiques de la structure externe et interne. Complication de la structure du tégument, des systèmes digestif, respiratoire, circulatoire, excréteur, nerveux, organes sensoriels, comportement par rapport aux reptiles.
Laboratoireet moitravauxet n ° 11.
Observations d'animaux vivants. Bâtiment extérieur. Etude de la structure du squelette d'un mammifère. Etude de la structure interne à l'aide de préparations humides prêtes à l'emploi.
Cible: Créer les conditions d'un apprentissage de haute qualité du matériel sur les mammifères ; élargir la compréhension des élèves sur la diversité du monde animal ; présenter les caractéristiques générales et les traits distinctifs des animaux de la classe des mammifères ; susciter l'intérêt pour le sujet, cultiver la diligence et la précision lors de l'exécution des tâches dans un cahier ; développer des compétences d'étude indépendantes; continuer à développer la capacité de travailler avec un manuel et un cahier, trouver dans le texte les informations nécessaires pour répondre aux questions, comparer, dresser des tableaux et des diagrammes, tirer des conclusions ; développer les capacités de communication des élèves par le dialogue.
Type de cours : combiné
Technologies pédagogiques : développement de la pensée critique, apprentissage par problèmes
Équipement: présentation, tableau interactif, projecteur
résultat attendu: les élèves sont capables de caractériser la classe Mammifères ; connaître les traits distinctifs de la classe ; sont capables de comparer une nouvelle classe d’animaux avec celles déjà étudiées ; sont capables de décrire la structure externe et interne ; participer activement au dialogue, comparer, généraliser et tirer des conclusions ; effectuer avec soin et autonomie les tâches proposées par l'enseignant.
PENDANT LES COURS
| Étapes de la leçon | Activités des enseignants | Activité étudiante | Remarques |
| je. Organisation du temps | 1. Organisation des activités des étudiants et ambiance émotionnelle positive pour la poursuite du travail créatif en classe. 2. Exprimez le plan de cours. | 1. La classe est complètement prête à travailler. | |
| II. Actualiser les connaissances, vérifier l'assimilation du matériel étudié sur les oiseaux | 1. Composez 3 questions basées sur le matériel étudié « Classe d'oiseaux » 2. Concours pour experts en oiseaux. 3 personnes se rendent au tableau et répondent aux questions de la classe. 3. Résumer la scène. | 1. Travailler à la rédaction de questions 2. Concours pour la meilleure question 3. Formuler des conclusions. | |
| III. Apprendre du nouveau matériel. | 1. Étape de motivation. Fournir de la motivation pour les activités des étudiants. 2. Exprimer le sujet de la leçon, organiser pour déterminer les objectifs des activités de la leçon. Exercice: Regarder les photographies d'animaux, déterminer à quelle classe ils appartiennent ? Justifiez votre réponse. Créer une situation problématique: pourquoi les mammifères sont-ils au plus haut niveau de développement par rapport aux autres accords ? 1. Caractéristiques générales de la classe Mammifères : Mammologie, tériologie Environ 4 000 espèces. Animaux à sang chaud, fourrure. Viviparité. Nourrir les jeunes avec du lait. Gros cerveau (les hémisphères antérieurs sont bien développés). Comportement varié et complexe. Ils ont diverses adaptations aux conditions de vie. Différenciation des dents. Présence d'une oreille externe. Présence de diverses glandes. 2. Travailler avec le manuel, p. 224. Milieux de vie mammifères : air, eau, sol-air, sol. 3. Étudier du nouveau matériel en utilisant les connaissances existantes, en travaillant avec un manuel Travail de laboratoire n°11 Etude de la structure externe et interne des mammifères. CIBLE: PROGRÈS: 6. Tirez une conclusion. | 2. Notez le sujet de la leçon dans des cahiers. 3. Détermination conjointe des objectifs de la leçon 1. Travaillez avec le texte du manuel p. 224, sélectionnez les caractéristiques des mammifères. Écrivez les définitions des sciences des mammifères. 2. Déterminer les caractéristiques d'adaptation des animaux à leur environnement. 3. Étude indépendante de nouveaux matériaux, effectuer des travaux de laboratoire. | |
| IVRésumer. Consolidation primaire | 1. Résumer les travaux de laboratoire. 2. Comparaison des oiseaux et des mammifères, identifiant les traits distinctifs et les signes de complexité. | 1. Participez à la conversation, formulez des conclusions. 2. Identifier les traits distinctifs des mammifères et les signes de complexité. | |
| VRésumer la leçon. Réflexion | Méthode des phrases incomplètes : 1. Pendant la leçon, j'ai travaillé _______ 2. Grâce à mon travail en classe I___________ 3. La leçon m'a semblé _________ 4. Pour la leçon, je _______ 5.Le matériel de cours était _______ pour moi Mon humeur: | Exprimez leur opinion sur la leçon et leur rôle dans la leçon. | |
| VIDevoirs | 61 $, résumés, rapports sur les oiseaux, les mammifères | Enregistrement des devoirs et notation |
Travail de laboratoire n°11
SUJET : Observations d'animaux vivants. Bâtiment extérieur. Etude de la structure du squelette d'un mammifère. Etude de la structure interne à l'aide de préparations humides prêtes à l'emploi.
OBJECTIF : étudier les caractéristiques structurelles des mammifères et de leur squelette
ÉQUIPEMENT : illustrations de divers représentants de la classe Mammifères, dessins de manuels
PROGRÈS:
Nommez les principales caractéristiques des mammifères. Déterminez leur habitat. Quelle science étudie la classe des mammifères ?
Étudier la structure externe des mammifères. Décrivez la forme du corps et indiquez de quelles parties il se compose.
Quelle est la structure de la peau des mammifères ? Quelle est l’importance de la fourrure dans la vie d’un animal ?
Examinez la tête d'un mammifère. Déterminez quels organes se trouvent dessus. Nommez les organes avec lesquels un animal navigue dans son environnement.
Étudiez les caractéristiques structurelles du squelette des mammifères. Dessinez un dessin du squelette d'un chien et étiquetez les principales parties du squelette.
Tirer une conclusion.
Structure squelettique d'un chien

Classe: 7
Travaux pratiques n°1
« Observer la croissance et le développement des animaux »
Cible: observation de la croissance et du développement des animaux à l'aide de l'exemple des chatons
Équipement: chat avec des chatons nouveau-nés.
Progrès
Effectuer des observations de chatons nouveau-nés. Découvrez quel jour après la naissance leurs yeux s'ouvrent et comment le comportement des chatons change par la suite. Observez comment l'attitude de votre chat envers ses chatons change à mesure qu'ils grandissent. Remarquez quand les chatons deviennent complètement indépendants.
Regardez les chatons jouer. Observez si les chatons commencent à jouer seuls ou si leur mère les encourage au départ à le faire. Déterminez à quel âge ils poursuivent un objet en mouvement (un morceau de papier attaché à une ficelle).
Travaux pratiques n°2
«Observation des changements saisonniers dans la vie des animaux NSO»
Cible: observation des changements saisonniers dans la vie des animaux à l'aide de l'exemple des oiseaux du district de Kupinsky de la région de Novossibirsk.
Équipement: oiseaux du pays natal
Progrès
I. Observations des oiseaux en automne
Fixez des dates précises à l’automne :
a) les premiers chants des jeunes mâles ;
b) l'apparition des premiers troupeaux de canards, de grues et d'oies ;
c) l'apparition de troupeaux de freux et d'étourneaux.
Noter la composition des troupeaux, leurs effectifs, le sex-ratio, le nombre de jeunes et de vieux (par plumage) ; la direction de leurs déplacements tout au long de l'automne.
Notez vos observations dans votre cahier.
II. Observations d'oiseaux en hiver
Quels oiseaux hivernants connaissez-vous ?
Apprenez à reconnaître les traces d'un corbeau, d'un choucas, d'une pie dans la neige et utilisez-les pour déterminer ce que faisaient les oiseaux.
Observez les oiseaux pendant le gel, le dégel, avant les chutes de neige. Reliez leur comportement à la météo.
En plaçant quotidiennement de la nourriture dans une mangeoire près de chez vous (toujours à certaines heures), observez à quelle heure les moineaux et les mésanges commencent à voler pour se nourrir, s'ils demanderont de la nourriture, si le troupeau entier apparaîtra en même temps ou si le les éclaireurs d'abord.
Dessinez les traces et notez vos observations dans votre cahier.
III. Observations des arrivées d'oiseaux au printemps
Fixez des dates précises au printemps :
a) l'apparition des premiers freux et étourneaux ;
b) le vol des premiers troupeaux de canards, grues, oies ;
c) les premiers chants de l'étourneau et du coucou.
Observations du nourrissage des poussins par les oiseaux d'ornement (perroquets, canaris)
Notez la date à laquelle les œufs commencent à incuber. Observez les oiseaux pendant l'incubation (qui incube les œufs, comment les oiseaux se nourrissent à ce moment-là). Célébrez le jour où les poussins apparaissent. Comment le comportement des parents a-t-il changé par la suite ?
Réglez la fréquence d'alimentation des poussins dans l'heure. Notez la date à laquelle les poussins quittent le nid.
Notez vos observations dans votre cahier.
Travail de laboratoire n°3
"Etude de la structure externe d'un mammifère"
Cible:étudier les caractéristiques de la structure externe d'un mammifère.
Équipement: animaux de compagnie ou mammifères empaillés, tableaux et dessins représentant des mammifères.
Progrès
Considérez n'importe quel mammifère terrestre - chien, chat, lapin, etc. Découvrez en quelles sections le corps d'un mammifère peut être divisé. Rappelez-vous quels vertébrés nous avons étudiés ont les mêmes parties du corps. Par quelles caractéristiques les mammifères peuvent-ils être distingués des autres animaux ?
Comment se déplace un mammifère ? Considérez les membres. Comptez les orteils de vos pieds avant et arrière. Quelles formations y a-t-il sur les doigts ?
Quels organes se trouvent sur la tête d'un mammifère ? Lequel de ces organes manque chez les autres vertébrés ?
Découvrez si les poils sont répartis uniformément sur le corps du mammifère. La racine des cheveux est-elle uniforme ? A quels endroits n'y a-t-il pas de cheveux ? Quelle est sa fonction principale ?
Établir les fonctions caractéristiques de chaque type de poils recouvrant le corps des mammifères. Pour ce faire, utilisez les données ci-dessous. Reflétez les résultats dans le tableau.
1. Poils de garde longs, forts et grossiers.
2. Sous-poil ou sous-poil - poils doux, épais et courts.
3. Poils longs, gros et sensoriels, à la base desquels se trouvent des fibres nerveuses qui détectent le contact avec des corps étrangers.
A. Remplir la fonction des organes du toucher.
B. Ils retiennent bien la chaleur, car beaucoup d’air est emprisonné entre ce type de cheveux.
B. Protège la peau des dommages.
Formulez et écrivez dans votre cahier une conclusion sur les caractéristiques de la structure externe des mammifères.
Travail de laboratoire n°2
"Etude de la structure interne d'un mammifère"
Cible:étudier les caractéristiques de la structure interne d'un mammifère.
Équipement: dessins et tableaux « Tapez Chordata. Classe Mammifères. Structure interne d'un chien", "Type Chordata. Classe Mammifères. Structure interne du lapin", "Type Chordates. Schémas circulatoires des vertébrés".
Progrès
1. Identifiez les caractéristiques de la structure interne d'un mammifère en utilisant l'exemple d'un chien ou d'un lapin.
Trouvez les organes du système digestif d'un mammifère dans les images et le tableau du manuel ; quelles divisions sont présentes, quelle est leur séquence, étant donné que le mammifère est un animal cordé.
2. Trouvez les organes du système respiratoire dans les images et le tableau du manuel. Expliquez quelles caractéristiques structurelles des poumons contribuent à la saturation rapide du sang en oxygène.
3. Trouvez les organes du système circulatoire dans les images et le tableau du manuel. Examinez attentivement le schéma de la structure du cœur. Comment l’apparition d’un cœur à quatre chambres a-t-elle affecté le métabolisme ? À l'aide du diagramme circulatoire, déterminez dans quel ventricule commencent la circulation systémique et la circulation pulmonaire. Dans quelles parties du cœur circule le sang artériel et dans quelles parties du cœur circule le sang veineux ?
4. Trouvez les organes du système excréteur dans les images et le tableau du manuel. Quelle fonction remplissent-ils ?
5. Remplissez le tableau
6. Conclure quelles complications sont survenues dans la structure et le fonctionnement des systèmes organiques internes des mammifères par rapport aux reptiles ?
Travaux pratiques n°3
"Observation du comportement animal"
Cible:étudier le comportement animal en prenant l'exemple des chats, des chiens, etc.
Équipement: Animaux domestiques
Progrès
1. Découvrez comment ces animaux réagissent aux odeurs et aux sons. Remplissez le tableau
2. Développer des réflexes conditionnés chez un chat, un chien ou autre : lors de l'alimentation.
3. Nourrissez l'animal 2 fois par jour à la même heure pendant une semaine. Passé ce délai, ne donnez pas de nourriture à l'animal à l'heure indiquée. Observez la réaction de l'animal et tirez des conclusions.
4. Notez les résultats de vos observations dans votre cahier.
Travail de laboratoire n°3
« Etude de la structure externe et de la diversité des arthropodes »
Cible: étudier les caractéristiques de la structure externe des arthropodes à l'aide de l'exemple du hanneton ; se familiariser avec la diversité des arthropodes.
Équipement: hanneton, bain, couteau à dissection, loupe ou dessins d'arthropodes de différentes classes, collections d'arthropodes.
Progrès
I. Étudier les caractéristiques de la structure externe du type d'arthropode en utilisant l'exemple de la classe d'insectes, le coléoptère
1. Examinez un hanneton non divisé, déterminez sa taille et la couleur de son corps.
2. Sur un coléoptère démembré, trouvez trois sections du corps : tête, poitrine, abdomen.
3. Examinez la tête du coléoptère, trouvez-y des antennes - organes du toucher, de l'odorat, des yeux - organes de la vision et organes buccaux.
4. Établissez les caractéristiques structurelles des pattes du coléoptère, déterminez leur nombre et à quelle partie du corps elles sont attachées.
5. Sur la poitrine du coléoptère, trouvez deux paires d’ailes : la paire avant, ou élytres, et la paire arrière, les ailes membraneuses.
6. Examinez l'abdomen, trouvez des encoches dessus et examinez les stigmates avec une loupe.
7. Esquissez un hanneton
II. Introduction à la diversité des arthropodes.
1. Créez un tableau « Caractéristiques structurelles des classes d’arthropodes ».
2. Identifiez les similitudes et les différences.
Travail de laboratoire n°4
"Identification des caractéristiques de la structure externe des poissons en lien avec leur mode de vie"
Cible:étudier les caractéristiques de la structure externe des poissons associées à la vie en milieu aquatique.
Équipement: perche ou poisson d'aquarium, dessins représentant différents types de poissons.
Progrès
1. Regardez un poisson nageant dans un pot d'eau ou dans un aquarium, déterminez la forme de son corps et expliquez l'importance de cette forme corporelle dans sa vie.

2. Déterminez de quoi est recouvert le corps du poisson, comment se trouvent les écailles, quelle importance cette disposition des écailles a-t-elle pour la vie du poisson dans l'eau. Utilisez une loupe pour examiner les écailles individuelles. Esquissez-le. Déterminez l'âge du poisson par des écailles. Comment as-tu fais ça?

3. Déterminez la couleur du corps du poisson sur les faces ventrale et dorsale ; si c'est différent, expliquez ces différences.
4. Trouvez les parties du corps du poisson : tête, corps et queue, déterminez comment elles sont reliées les unes aux autres, quelle importance une telle connexion a dans la vie d'un poisson.
5. Trouvez les narines et les yeux sur la tête du poisson, déterminez si les yeux ont des paupières et quelle importance ces organes ont dans la vie du poisson.
6. Trouvez des nageoires appariées (pectorales et ventrales) et des nageoires impaires (dorsales, caudales) sur le poisson que vous envisagez. Observez l'action des nageoires lorsque le poisson se déplace.
7. Esquissez l’apparence du poisson, indiquez les parties de son corps dans le dessin et tirez une conclusion sur l’adaptabilité du poisson à la vie dans l’eau. Écrivez votre conclusion dans votre cahier.
Travail de laboratoire n°5
"Identification des caractéristiques de la structure externe d'une grenouille en lien avec son mode de vie"
Cible:étudier les caractéristiques de la structure externe de la grenouille en lien avec son mode de vie.
Équipement: bain, grenouille ou préparation humide, modèle, dessins représentant une grenouille.
Progrès

1. Examinez le corps de la grenouille et trouvez les parties du corps dessus.
2. Examinez le tégument du corps.
3. Examinez la tête de la grenouille, faites attention à sa forme et à sa taille ; regardez les narines ; trouvez les yeux et faites attention aux caractéristiques de leur emplacement, si les yeux ont des paupières, quelle importance ces organes ont dans la vie d'une grenouille.
4. Examinez le corps de la grenouille et déterminez sa forme. Sur le corps, retrouvez les membres avant et arrière, déterminez leur emplacement.
5. Dessinez l’apparence de la grenouille, étiquetez ses parties du corps dans le dessin et tirez une conclusion sur l’adaptabilité de la grenouille à la vie dans l’eau et sur terre. Écrivez votre conclusion dans votre cahier.
Travail de laboratoire n°6
"Identification des caractéristiques de la structure externe des oiseaux en lien avec leur mode de vie"
Cible:étudier les caractéristiques de la structure externe des oiseaux associées à l'adaptation au vol.
Équipement: un ensemble de plumes, un oiseau en peluche, une loupe ou un oiseau vivant, des dessins d'oiseaux.
Progrès

1. Examinez l'oiseau en peluche et trouvez les parties du corps dessus : tête, cou, torse, queue.
2. Examinez la tête de l’oiseau, faites attention à sa forme et à sa taille ; trouver le bec, composé d'une mandibule et d'une mandibule ; sur le bec, regardez les narines ; trouvez les yeux et faites attention aux caractéristiques de leur emplacement.
3. Examinez le corps de l'oiseau, déterminez sa forme. Trouvez les ailes et les pattes sur le corps et déterminez leur emplacement. Faites attention à la partie sans plumes de la jambe - le tarse et les orteils avec des griffes. De quoi sont-ils recouverts ? Rappelez-vous quels animaux vous avez étudiés plus tôt avaient une telle couverture.

4. Examinez la queue de l’oiseau, constituée de plumes, et comptez leur nombre.
5. Examinez l'ensemble des plumes, trouvez parmi elles la plume de contour et ses parties principales : un tronc étroit et dense, sa base - la plume, des éventails situés des deux côtés du tronc. À l'aide d'une loupe, examinez les éventails et trouvez les barbes de 1er ordre - ce sont des plaques cornées s'étendant du tronc.
6. Dessinez la structure du stylo contour dans un cahier et écrivez les noms de ses parties principales.

7. Examinez un duvet, trouvez les plumes et les éventails, dessinez cette plume dans un cahier et écrivez les noms de ses parties principales.
8. Sur la base de l'étude de la structure externe de l'oiseau, notez les caractéristiques associées au vol. Prenez note dans votre cahier.
Travaux pratiques n°4
"Déterminer l'appartenance des animaux à un certain groupe systématique"
Cible: apprenez à déterminer si les animaux vivant dans le NSO appartiennent à un certain groupe systématique en utilisant l'exemple des invertébrés.
Équipement: cartes d'identification des animaux invertébrés.
Progrès
1. À l’aide du tableau d’identification des commandes d’insectes, déterminez à quelle commande appartiennent les insectes qui vous sont proposés et inscrivez le nom de la commande dans le tableau.
Clé des commandes d'insectes
1) Une paire d'ailes. Le postérieur est modifié en licol commander des Diptères
– Il y a deux paires d’ailes………………………………………………………………………………………2
2) Les ailes des deux paires sont membraneuses…………………………………………………………..3
– Les paires d'ailes avant et arrière diffèrent les unes des autres par leur structure…………………7
3) Ailes transparentes…………………………………………………………………………………... 4
– Les ailes sont opaques, densément couvertes d'écailles ; pièces buccales en forme de spirale
trompe tordue……………………………… ordre des Lépidoptères (papillons)
4) Les ailes avant et arrière ont à peu près la même longueur…………………………5
– Ailes avant et arrière de différentes longueurs……………………………………………………………6
5) Les ailes sont riches en nervures ; tête avec de grands yeux et des antennes courtes ;
pièces buccales rongeantes; abdomen mince et allongé (sa longueur dépasse sa largeur
5 à 10 fois) ………………………………………………………. Escouade de libellules
– Les branches des nervures au bord des ailes sont nettement fourchues ; antennes situées entre les yeux
………………………………………………………commander des Reticulata
6) La paire d'ailes arrière est liée à l'avant et est plus petite qu'elle ; au repos les ailes
se replie le long du corps, a souvent une piqûre………………… ordre des Hyménoptères
– La paire d’ailes arrière est souvent beaucoup plus courte que l’avant ; le corps est allongé avec des revêtements souples ;
les organes buccaux sont réduits ; abdomen, à l'exception d'une paire de longs cerques polysegmentés,
a souvent un appendice caudal non apparié similaire ; comme un adulte
vit de plusieurs heures à plusieurs jours……………………………… Escouade d'éphémères
7) La paire d'ailes antérieures s'est transformée en élytres durs opaques, dépourvus de
nervure évidente; au repos, les élytres se replient pour former une suture longitudinale
……………………………………………………………..ordre des Coléoptères (coléoptères)
– La paire d'ailes avant a une structure différente…………………………………………………………8
8) La paire d'ailes antérieures se transforme en demi-élytres avec une partie apicale membraneuse
et un reste coriace plus dense ; au repos, les ailes sont généralement repliées à plat sur le dos
…………………………………………………..commander des hémiptères (bugs)
– Les ailes sont divisées en élytres coriaces allongés plus denses et en un large,
paire arrière rabattable en forme d'éventail …………………… …. ordre des orthoptères
2. Comparez les insectes entre eux selon les caractéristiques indiquées dans le tableau.
Caractéristiques à titre de comparaison |
Nom de l'équipe |
||||||||||||
Type d'antenne |
|||||||||||||
Type de pièces buccales |
|||||||||||||
Nombre d'ailes |
|||||||||||||
Caractéristiques de la structure des ailes |
|||||||||||||
Type de membre |
|||||||||||||
Caractéristiques de la structure de la tête |
|||||||||||||
Caractéristiques de la structure du sein |
|||||||||||||
Caractéristiques de la structure de l'abdomen |
|||||||||||||
3. Identifier les signes de similitude dans la structure externe des insectes.
Fiches de travaux pratiques n°4
À l’aide du tableau d’identification des commandes d’insectes, déterminez à quelle commande appartiennent les insectes qui vous sont proposés et inscrivez le nom de la commande dans le tableau.
Carte n°0

Carte n°1

Carte n°2
Des insectes de l'ordre ________________________________ ?

Carte n°3
Des insectes de l'ordre ________________________________ ?

Carte n°4
Des insectes de l'ordre ________________________________ ?

Carte n°5
Des insectes de l'ordre ________________________________ ?

Carte n°6
Des insectes de l'ordre ________________________________ ?

Carte n°7
Des insectes de l'ordre ________________________________ ?

Carte n°8
Des insectes de l'ordre ________________________________ ?

Carte n°9
Des insectes de l'ordre ________________________________ ?

Travail de laboratoire n°7
« Identification des adaptations des animaux à l'habitat NSO »
Cible:étudier les caractéristiques des adaptations des animaux NSO à leur environnement.
Équipement: dessins d'animaux dans différents habitats.
Progrès
1. Déterminez l'habitat des animaux qui vous sont proposés dans les images.
2. Identifier les caractéristiques de l'adaptation à l'environnement.
3. Remplissez le tableau

4. Tirer une conclusion sur les adaptations possibles des animaux aux conditions environnementales.
Travail de laboratoire n°8
"Reconnaissance des animaux de compagnie"
Cible: apprendre à reconnaître les animaux domestiques, identifier leur importance pour l'homme.
Équipement: dessins d'animaux domestiques et sauvages.
Progrès
Dans la liste (1-15), sélectionnez les numéros des dessins représentant des animaux de compagnie. Remplissez le tableau.

Travail de laboratoire n°9
"Reconnaître les différents types d'animaux"
Cible: apprendre à reconnaître différents types d'animaux multicellulaires par leur structure externe.
Équipement: dessins d'animaux.
Progrès
1. Regardez les dessins de représentants d'animaux multicellulaires, déterminez leur nom et leur type. Remplissez le tableau.

2. Classez l'un des représentants.
Espèce – chien domestique
Genre -
Famille -
Équipe -
Classe -
Taper -
Royaume -
Travail de laboratoire n°10
« Reconnaissance des organes et des systèmes organiques chez les animaux »
Cible: apprendre à reconnaître les systèmes organiques et leurs organes composants chez les animaux.
Équipement: dessins de systèmes d'organes animaux.
Progrès
1. Regardez les images, déterminez sous quel numéro un certain système est affiché et entrez-le dans le tableau.
| № | Nom des systèmes | Organes et leurs composants | Les fonctions |
| Appareil locomoteur Sang Respiratoire excréteur Sexuel Nerveux Endocrine |
A – cœur et vaisseaux sanguins B – Ovaires et testicules B – Squelette et muscles G - Estomac, intestins, ... D - Reins, vessie, ... E – Glandes qui sécrètent des hormones F - Trachée, branchies, poumons, ... H – Cerveau et moelle épinière, nerfs |
1 – Apport d’oxygène dans l’organisme, élimination du dioxyde de carbone. 2 – Soutien, protection des organes internes, mouvement. 3 – Élimination des produits métaboliques liquides. 4 – Reproduction 5 – Transport de substances dans l’organisme. 6 – Digestion des aliments et absorption des nutriments dans le sang 7 – Coordination et régulation des activités de l’organisme. |
2. Retrouver la correspondance : le nom des systèmes – les organes qui les composent – et leurs fonctions.
Système musculo-squelettique -
Système circulatoire -
Système respiratoire -
Système excréteur -
Système reproducteur -
Système nerveux -
Système endocrinien -






Zoologie – une discipline scientifique qui étudie le monde animal, composante majeure de la biologie. Sur la base des objectifs de l'étude, la zoologie est divisée en un certain nombre de disciplines : systématique, morphologie, embryologie, génétique animale, zoogéographie, etc. Sur la base des objets de recherche, on distingue la protozoologie, qui étudie les protozoaires, la zoologie des invertébrés et des vertébrés zoologie. Le dernier objet d'étude comprend Tériologie, étude des mammifères.
L'émergence des mammifères est devenue possible grâce à la formation d'un certain nombre de grandes aromorphoses, qui ont réduit la dépendance des animaux aux changements de l'environnement extérieur. Les mammifères ont évolué à partir d'anciens reptiles au tout début de l'ère mésozoïque, c'est-à-dire plus tôt que les oiseaux, mais le développement qui a conduit à la richesse moderne des formes de cette classe de vertébrés remonte à l'ère Cénozoïque, après l'extinction des grands reptiles.
Caractéristiques communes des mammifères
Les mammifères sont des vertébrés à sang chaud du groupe des amniotes. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit du groupe d'animaux terrestres le plus spécialisé, qui se distingue par les caractéristiques progressives suivantes.
1. Système nerveux central et organes sensoriels très développés. Le cortex cérébral, formé de matière grise, apparaît, ce qui assure un niveau élevé d'activité nerveuse et un comportement adaptatif complexe.
2. Système de thermorégulation, assurant une relative constance de la température corporelle.
3. Viviparité (sauf ovipares) et alimentation des petits avec le lait maternel, ce qui assure une meilleure sécurité de la progéniture.
La hauteur de l'organisation des mammifères s'exprime également dans le fait que tous leurs organes réalisent la plus grande différenciation et que le cerveau a la structure la plus parfaite. Le centre de l'activité nerveuse supérieure y est particulièrement développé - le cortex cérébral, constitué de matière grise du cerveau. À cet égard, les réactions et le comportement des mammifères atteignent une perfection exceptionnelle. Ceci est facilité par des organes sensoriels très complexes, notamment l'ouïe et l'odorat. Le développement progressif rapide des mammifères a également été facilité par la différenciation des dents en incisives, canines et molaires.
L'acquisition du sang chaud, c'est-à-dire une température corporelle constamment élevée, a joué un rôle important dans le développement de ce groupe. Cela se produit en raison de : a) une circulation sanguine non mélangée, b) des échanges gazeux améliorés, c) des dispositifs de thermorégulation. La circulation sanguine non mélangée, comme chez les oiseaux, est obtenue grâce à un cœur à quatre chambres et à la préservation d'un seul arc aortique (gauche) chez les animaux. L’acquisition d’une structure alvéolaire pulmonaire et l’apparition d’un diaphragme entraînent une augmentation des échanges gazeux. Diaphragme- Il s'agit d'une cloison musculaire qui divise complètement le corps en deux parties : la thoracique et l'abdominale. Le diaphragme est impliqué dans l’acte d’inspiration et d’expiration. Thermorégulation obtenu par l’apparition des cheveux et des glandes cutanées.
Grâce à la perfection des systèmes digestif, respiratoire et circulatoire, l'ensemble du métabolisme des mammifères se déroule de manière très intensive, ce qui, associé à une température corporelle élevée, les rend moins dépendants des conditions climatiques environnementales que les amphibiens et les reptiles. Le développement progressif rapide des animaux est également dû au fait que les plus élevés d'entre eux ont développé la viviparité. L'embryon est nourri dans l'utérus par un organe spécial - placenta. Après la naissance, le bébé est nourri au lait. Il est sécrété par des glandes mammaires spéciales. Tout cela augmente considérablement le taux de survie de la progéniture. Grâce à la hauteur de leur organisation et à leur psychisme parfait, au début de l'ère Cénozoïque (il y a 65 millions d'années), les mammifères ont pu déplacer les reptiles qui dominaient jusqu'alors la Terre et occuper tous les principaux habitats.
Caractéristiques structurelles des mammifères
Bâtiment extérieur. Les animaux ont une tête, un cou, un corps et une queue bien définis. La tête se distingue généralement entre la région crânienne, située derrière les yeux, et la région faciale, ou museau, située devant. Les yeux sont équipés d'une paupière supérieure, inférieure et d'une troisième paupière. Contrairement aux oiseaux, la membrane nictitante (troisième paupière) ne couvre que la moitié de l'œil du mammifère. De grandes oreilles sont situées sur les côtés de la tête et des narines appariées se trouvent au bout du museau.
Riz. 1. Diagramme de structure des mammifères
1- peau ; 2 - crâne; 3 - colonne vertébrale; 4 - cavité buccale ; 5 - pharynx ; 6 - œsophage ; 7 - estomac; 8 - intestin grêle; 9 - gros intestin ; 10 - foie; 11 - reins; 12 - uretères ; 13 - trachée; 14 - poumons; 15 - coeur; 16 - diaphragme; 17 - cerveau; 18 - moelle épinière; 19 - glande sexuelle
La bouche est tapissée de lèvres charnues caractéristiques des mammifères. La lèvre supérieure est généralement recouverte de poils très raides appelés vibrisses. Plusieurs d'entre eux sont situés au-dessus des yeux. Ils jouent le rôle d'organes tactiles supplémentaires. Sous la racine de la queue se trouve une ouverture anale et, un peu en avant, une ouverture génito-urinaire. Chez les femelles, il y a 4 à 5 paires de mamelons sur les côtés du corps, sur la face ventrale. Les membres sont à cinq ou quatre doigts, les doigts sont armés de griffes.
Peau. La fourrure qui recouvre le corps des mammifères est un dérivé de la peau. Il existe deux types de cheveux – les cheveux de garde et les cheveux doux – les cheveux duveteux. La peau est constituée de deux couches principales : l'épiderme et le corium. La première est une fine couche cornée et la seconde est très épaisse et dense. Sa partie inférieure forme le tissu sous-cutané.
Les cheveux sont une formation cornée. Il comporte une partie inférieure élargie - le bulbe - et une longue tige dépassant vers l'extérieur ; sa partie inférieure, avec le bulbe, forme la racine du poil, située dans le sac. Dans le bâtonnet, au microscope, 3 couches de cellules sont visibles : la cuticule, la couche intermédiaire et le noyau. Les cheveux contiennent des pigments qui déterminent leur couleur. La couleur des cheveux blancs est parfois associée à la présence d’air à l’intérieur des cellules. Chez la plupart des animaux, les poils sont divisés en 2 à 3 catégories principales (Fig. 1).
De longs poils de garde sont visibles à l'extérieur de la fourrure ; en dessous se trouve un sous-poil épais et délicat ; souvent, des poils guides encore plus longs sont visibles parmi la colonne vertébrale. Les cheveux ne sont pas disposés au hasard, mais en certains groupes. La forme des poils individuels et le type de leur répartition sont caractéristiques de chaque espèce animale.

Riz. 2. Structure de la peau et types de poils des mammifères (d'après Geiler, 1960)
1 - sous-poil; 2 - garde les cheveux; 3 - couche cornée de l'épiderme ; 4 - Couche malpighienne ; 5 - corium; 6 - muscle du follicule pileux; 7 - glande sébacée ; 8 - racine des cheveux; 9 - papille pileuse; 10 - vaisseau sanguin; 11 - glande sudoripare
Une modification particulière du poil est représentée par des vibrisses, ou poils tactiles, situés en groupes sur le museau (« moustaches », etc.), et parfois sur les pattes et la face ventrale du corps. Les modifications de la racine des cheveux incluent également les poils durs d'un sanglier, les piquants d'un porc-épic, d'un hérisson, etc. La racine des cheveux joue un rôle très important dans la vie des animaux : elle les protège des effets néfastes de l'environnement, aide à réguler leur corps. température et camoufle souvent l'animal. Le poil (fourrure) atteint son meilleur développement chez les animaux des climats froids et tempérés. L'apparition des poils en cours d'évolution s'est avérée être une adaptation très importante qui a facilité l'existence des animaux dans les paysages les plus défavorables à la vie.
La racine des cheveux se développe à mesure que l'animal vieillit et est remplacée périodiquement tout au long de l'année. Généralement, la mue est saisonnière, parfois accompagnée d'un changement de couleur. Elle dépend étroitement des changements saisonniers des conditions météorologiques. La plupart de nos animaux terrestres ont un poil d’hiver beaucoup plus épais et luxuriant que celui d’été. Ainsi, sur le dos d'un écureuil, sur une surface cutanée de 10 mm2, on compte 46 groupes de poils en été, et 89 en hiver, soit presque deux fois plus. La longueur des poils de garde passe de 11 à 20 mm et la longueur du sous-poil de 7 à 12 mm. Le dimorphisme saisonnier des poils est faiblement exprimé chez les animaux fouisseurs, hibernants et aquatiques.
La plupart des espèces ont 2 mues, mais chez certaines, leur nombre atteint 3-4. Le moment du début et la durée des mues dépendent des conditions météorologiques, du sexe, de l’âge et de l’obésité de l’animal et varient donc d’une année à l’autre. Mais l’ordre des changements saisonniers de poils sur certaines parties du corps est naturel et est généralement maintenu chaque année. Dans ce cas, la mue printanière et automnale se produit généralement dans l'ordre inverse (de la tête à la queue et vice versa). La chair des zones de mue de la peau devient bleue, ce qui facilite l'étude du processus de mue. Chez les animaux terrestres, le changement de poils se produit dans un laps de temps relativement court, notamment au printemps, tandis que chez les animaux aquatiques et semi-aquatiques, il s'étend considérablement dans le temps. Le poil des animaux aquatiques présente des différences saisonnières beaucoup moins marquées et reste relativement épais même en été. Cela est dû à des fluctuations de température plus faibles et à une conductivité thermique accrue de l'eau, ce qui nécessite une bonne protection contre le refroidissement toute l'année.
Certains mammifères (lièvre blanc, hermine, belette, renard arctique) blanchissent pour l'hiver. Le moment du blanchissement coïncide généralement avec les dates moyennes à long terme d’établissement de la couverture neigeuse. Mais certaines années, cette coïncidence ne fonctionne pas, et le blanchiment prématuré des lièvres s'avère parfois désastreux pour eux. La couleur blanche a une valeur de masquage (cryptique). Les hypothèses sur son rôle dans la thermorégulation n'ont pas été confirmées par des expériences spécialement menées.
La coloration estivale a parfois aussi une signification protectrice, camouflant bien un animal caché ; par exemple, le motif tacheté des jeunes chevreuils et cerfs, le motif rayé des jeunes sangliers, la coloration sableuse de nombreux rongeurs du désert, etc. Dans certains cas, la nature de la coloration s'expliquerait apparemment par l'influence de la température, de l'air. l'humidité et d'autres facteurs environnementaux. Ce n'est pas un hasard si de nombreux animaux à fourrure de Sibérie orientale et de Yakoutie, où le climat est fortement continental, ont non seulement la fourrure la plus duveteuse, mais aussi la plus foncée (zibeline, écureuil).
Les cheveux sont étroitement liés à la peau. Il est composé de deux couches principales : l'épiderme superficiel et le corium plus profond, constitué principalement de tissu conjonctif fibreux. Les cellules de l'épiderme, à mesure qu'elles se rapprochent de sa surface, deviennent de plus en plus cornées, meurent et s'exfolient progressivement, étant remplacées par de nouvelles cellules provenant d'une couche plus profonde appelée couche malpighienne. La couche superficielle du corium se projette dans celui-ci sous forme de papilles. Dans ces papilles se développent de minuscules capillaires sanguins et des corpuscules tactiles. Plus profondément dans la peau se trouvent les vaisseaux sanguins, les nerfs et la graisse. La peau des mammifères est très riche en glandes - tubulaires et alvéolaires. Les premiers comprennent principalement les glandes sudoripares, les seconds les glandes sébacées. Comme mentionné ci-dessus, les glandes mammaires constituent une modification particulière des glandes tubulaires.
Les cheveux sont un dérivé de l'épiderme, bien que leurs racines soient situées dans des couches profondes de tissu conjonctif. Les dérivés de l'épiderme comprennent également des formations cornées telles que des griffes, des sabots, des écailles (par exemple, les carapaces de tatous et de lézards ; de petites écailles sur la queue d'un castor, d'un rat musqué, etc.), et partiellement les cornes de bovidés, dans lesquelles la substance cornée en forme de gaine recouvre le noyau osseux. Les griffes, les cornes et autres, comme les cheveux, subissent des changements liés à l'âge et aux saisons.
Squelette. La colonne vertébrale se compose de cinq sections : cervicale, thoracique, lombaire, sacrée et caudale. Les vertèbres ont des surfaces articulaires plates caractéristiques des mammifères et sont séparées les unes des autres par des disques cartilagineux ronds - les ménisques.
La région cervicale de tous les mammifères (à de très rares exceptions près) contient 7 vertèbres. (La souris et la girafe ont toutes deux 7 vertèbres cervicales). Ces vertèbres sont dépourvues de côtes libres. La région thoracique contient 12 à 13 vertèbres, toutes équipées de côtes. Les sept paires de côtes antérieures se connectent au sternum et sont appelées « vraies côtes ». Les cinq paires suivantes n'atteignent pas le sternum. La région lombaire est dépourvue de côtes et contient généralement 6 à 7 vertèbres. Le sacrum est formé chez la plupart des mammifères par quatre vertèbres fusionnées. Les antérieurs portent généralement deux processus, à l'aide desquels le bassin est articulé. La région caudale est très variable en nombre de vertèbres.

Figure 3. Squelette de mammifère
1 - crâne; 2 - mâchoire inférieure ; 3 - vertèbres cervicales ; 4 - vertèbres thoraciques ; 5 - vertèbres lombaires ; 6 - sacrum; 7 - vertèbres caudales ; 8 - côtes; 9 - sternum ; 10 - lame; 11 - humérus ; 12 - cubitus; 13 - rayon; 14 - os du carpe; 15 - os métacarpiens; 16 - phalanges des doigts du membre antérieur ; 17 - bassin; 18 - fémur; 19 - tibias ; 20 - péroné; 21 - os du tarse; 22 - os métatarsiens; 23 - phalanges des doigts du membre postérieur ; 24 - rotule
Le crâne est divisé en axial, constitué des os entourant le cerveau, et viscéral (facial), qui comprend les os entourant la bouche - le palais, les os des mâchoires supérieure et inférieure. La ceinture scapulaire n'est représentée que par l'omoplate et la clavicule, et les mammifères n'ont pas d'os du corbeau (coracoïde). Chez les coureurs rapides, la clavicule disparaît généralement (ongulés). La région pelvienne est constituée d'une paire d'os innomés, chacun étant formé par la fusion de l'ilion, de l'ischion et du pubis. Le squelette des membres appariés comporte trois sections typiques. Dans les membres antérieurs, il s’agit de l’épaule, de l’avant-bras et de la main, et dans les membres postérieurs, de la cuisse, du bas de la jambe et du pied. Chez les mammifères, un tendon arrondi, la rotule, apparaît au niveau de l'articulation du genou sur les membres postérieurs.
Système musculaire. Ce système chez les animaux atteint un développement et une complexité exceptionnels. Ils possèdent plusieurs centaines de muscles striés individuels. Une caractéristique du système musculaire des mammifères est la présence d'un diaphragme et l'apparition de muscles sous-cutanés. Le diaphragme est une cloison musculaire en forme de dôme qui sépare la région thoracique de la région abdominale. Au centre, il est perforé par l'œsophage. Le diaphragme participe aux actes de respiration et de défécation des animaux. Les muscles sous-cutanés représentent une couche sous-cutanée continue. Avec son aide, les animaux peuvent déplacer des zones de leur peau. Les mêmes muscles participent à la formation des lèvres et des joues. Chez le singe, il a presque disparu et n'est conservé que sur la face. Là, elle a reçu un développement inhabituellement fort - ce qu'on appelle les muscles du visage.
Système nerveux. Le cerveau de l'animal possède des hémisphères puissamment développés du cerveau antérieur et du cervelet. Ils couvrent toutes les autres parties du cerveau. Le cerveau antérieur est constitué des hémisphères cérébraux recouverts de matière cérébrale grise - le cortex cérébral. Les lobes olfactifs s'étendent vers l'avant à partir des hémisphères. Entre les hémisphères se trouve un large pont de fibres nerveuses blanches.
Le diencéphale possède un entonnoir et un chiasma optique, comme chez les autres classes de vertébrés. L'hypophyse est attachée à l'entonnoir du diencéphale, tandis que l'épiphyse est située au-dessus du cervelet sur une longue tige. Le mésencéphale est de très petite taille et, en plus du sillon longitudinal, il possède également un sillon transversal, caractéristique uniquement des mammifères. Le cervelet est constitué d'une partie non appariée - le vermis et de deux parties latérales très grandes et généralement appelées hémisphères cérébelleux. La moelle oblongate possède une caractéristique qui est également propre aux mammifères. Sur les côtés de ce cerveau se trouvent des faisceaux de fibres nerveuses allant au cervelet. On les appelle pédoncules cérébelleux postérieurs. La moelle allongée passe dans la moelle épinière.
Organes sensoriels. Ils sont très développés chez les mammifères et, conformément à la spécialisation écologique d'un groupe particulier, l'odorat, la vision, l'ouïe et le toucher revêtent une importance primordiale. Les organes auditifs des animaux sont particulièrement bien développés. Ils ont des tympans osseux et de grandes oreilles externes mobiles.
Organes digestifs. La cavité buccale est limitée chez les animaux par les lèvres. Les lèvres servent à saisir et à retenir les proies. La cavité buccale est limitée au-dessus par un palais osseux dur. De ce fait, les choanes (narines internes) sont repoussées vers le pharynx. Cela permet aux animaux de respirer pendant que la nourriture est dans la bouche. Les côtés de la cavité buccale sont limités par des joues molles et musclées et en bas se trouve une grande langue musclée. Ses fonctions sont de percevoir les sensations gustatives et de pousser les aliments sous les dents lors de la mastication et dans le pharynx lors de la déglutition. Les conduits des glandes salivaires s'ouvrent dans la bouche (4 glandes appariées - parotide, infra-orbitaire, sous-maxillaire et sublinguale). Les dents ne poussent pas à la surface de l'os, comme dans les classes précédentes, mais reposent dans des cellules indépendantes. Les dents sont différenciées en incisives, canines et molaires. La dent elle-même est constituée d'éléments tels qu'une couronne avec une surface de travail, le corps de la dent et sa racine. Le pharynx des animaux est court, la trachée et les choanes s'y ouvrent. Ainsi, chez les mammifères, le pharynx est le carrefour de deux voies : la voie alimentaire et la voie respiratoire. L'œsophage est un tube musculaire simple et très extensible. Après avoir traversé le diaphragme, il se connecte à l'estomac. L'estomac ressemble à une grande poche incurvée en forme de fer à cheval qui s'étend sur tout le corps. Un péritoine rempli de graisse pend à l'estomac et recouvre tous les organes internes comme un tablier. Le foie est situé sous le diaphragme, ses ruisseaux s'ouvrent dans le duodénum, dans l'anse duquel se trouve le pancréas. La plupart des mammifères ont une vésicule biliaire. Les intestins peuvent être de différentes longueurs, selon la composition de l'aliment. Le lapin herbivore a un intestin très long, 15 à 16 fois plus long que le corps. Ses sections sont les intestins grêle, gros et rectal. Au début du gros intestin chez les mammifères, il y a une excroissance aveugle non appariée - le caecum. L'intestin s'ouvre vers l'extérieur avec une ouverture anale indépendante.
Système respiratoire. Le larynx, comme d'habitude chez les mammifères, possède un cartilage cricoïde, devant lequel se trouve le gros cartilage thyroïde. Le larynx des mammifères est complexe. Les cordes vocales sont tendues à l'intérieur du larynx. Ce sont des plis élastiques appariés de la membrane muqueuse, étirés dans la cavité du larynx et limitant la glotte. Les poumons sont une paire de corps spongieux suspendus librement dans la cavité thoracique. Leur structure interne se caractérise par une grande complexité. La trachée près des poumons se divise en deux bronches. Les bronches qui pénètrent dans les poumons sont divisées en bronches secondaires, elles-mêmes divisées en bronches du troisième et du quatrième ordre. Ils se terminent par des bronchioles. Les extrémités des bronchioles sont gonflées et entrelacées de vaisseaux sanguins. Ce sont ce qu'on appelle les alvéoles, où se produisent les échanges gazeux.
Système circulatoire. Le cœur des animaux, comme celui des oiseaux, est composé de quatre chambres, le ventricule gauche pompant le sang dans la circulation systémique et, comme celui des oiseaux, ses parois sont beaucoup plus épaisses que le droit. Du ventricule gauche part un gros vaisseau - l'aorte, qui commence la circulation systémique. Le sang artériel alimente tous les organes du corps et le sang veineux est collecté par le système veineux. Les plus grandes d'entre elles - la veine cave postérieure et les deux veines caves antérieures - se jettent dans l'oreillette droite. De l'oreillette droite, le sang pénètre dans le ventricule droit, d'où commence la circulation pulmonaire ou, comme on l'appelle aussi, la circulation pulmonaire. Le sang veineux est éjecté du ventricule droit dans la grosse artère pulmonaire. Cette artère se divise en droite et gauche, menant aux poumons. De chaque poumon, le sang s'accumule dans la veine pulmonaire (le sang qu'elle contient est artériel), les deux veines fusionnent et s'écoulent dans l'oreillette gauche. Ensuite, depuis l'oreillette gauche, le sang se déverse dans le ventricule gauche et circule à nouveau dans la circulation systémique.
Organes, sécrétions. Chez les mammifères, il s'agit d'une paire de reins en forme de haricot situés dans la région lombaire. Du côté concave interne de chaque rein se trouve un uretère (un tube mince) qui se draine directement dans la vessie, qui s'ouvre dans l'urètre.
Organes génitaux. Chez les mammifères, il s'agit de testicules appariés (chez les mâles) ou d'ovaires appariés (chez les femelles). Les testicules ont une forme ovale caractéristique. Les appendices des testicules leur sont adjacents. Les canaux déférents appariés s'ouvrent au début de l'urètre. Les parties terminales du canal déférent sont élargies dans les vésicules séminales. Les ovaires appariés de la femelle ont une forme ovale-aplatie. Près de chaque ovaire se trouve un oviducte. À une extrémité, l'oviducte s'ouvre dans la cavité corporelle et à l'autre extrémité, il pénètre dans l'utérus sans bordure visible. L'utérus des animaux est à deux cornes, les cornes droite et gauche de l'utérus s'ouvrent indépendamment dans le vagin. Il n’est pas apparié. L'extrémité postérieure passe progressivement dans l'urètre et la vessie s'y débouche. Le vagin s'ouvre vers l'extérieur par l'orifice urogénital.
Développement de l'embryon. Les ovocytes se développent dans l'ovaire, puis les cellules matures sortent de l'ovaire dans la cavité corporelle et y sont capturées par l'entonnoir de l'oviducte. Grâce aux mouvements vacillants des cils du tube (oviducte), l'ovule se déplace le long de celui-ci, et si la femelle est fécondée, alors dans le tube (généralement dans son premier tiers) l'ovule et le sperme fusionnent. L'ovule fécondé continue de descendre lentement dans l'utérus et en même temps commence sa fragmentation (divisant l'ovule en plusieurs cellules). Ayant atteint l'utérus, l'œuf, qui s'est alors transformé en une boule multicellulaire dense, est incrusté dans la paroi. Là, les nutriments commencent à y affluer. Très vite, un placenta se forme autour de l’embryon implanté. Il s'agit de la membrane du fruit, très caractéristique des mammifères. Le placenta est un organe spongieux riche en vaisseaux sanguins, dans lequel se distinguent les parties infantile et maternelle. La pépinière est constituée des villosités de la membrane embryonnaire et celles de la mère - de la paroi de l'utérus. Lors de l'accouchement, la couche musculaire de l'utérus se contracte fortement et le placenta (chorion) du bébé, alors très légèrement relié à la membrane muqueuse de l'utérus, s'ouvre et sort avec le nouveau-né sous la forme d'une place d'enfant.